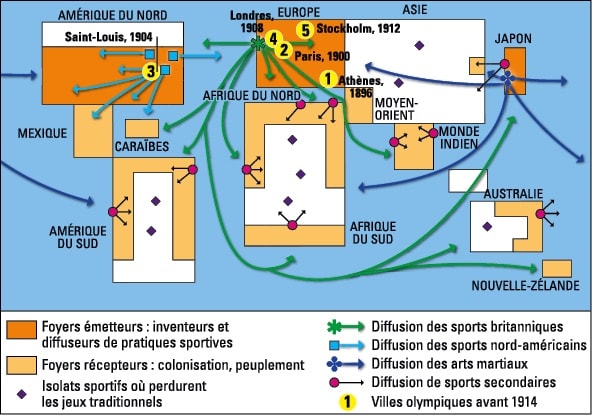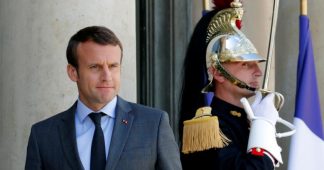Christophe Guilluy
Le Crépuscule de la France d’en haut
Flammarion, 2016
(Deux extraits)
Les nouvelles citadelles (p. 13-25)
Les citadelles médiévales sont de retour. Dans les métropoles mondialisées, une bourgeoisie contemporaine, « new school », a pris le pouvoir, sans haine ni violence. La captation des richesses, des emplois, du pouvoir politique et culturel s’est réalisée en douceur. On présente souvent la fracture française comme un affrontement entre les « élites » et le « peuple ». Pourtant, le système ne repose pas seulement sur les « élites », mais sur une fraction très importante de la population, une nouvelle bourgeoisie, qui réside notamment dans les métropoles et qui a cautionné tous les choix économiques de la classe dominante depuis trente ans.
Contrairement à la bourgeoisie d’hier, les nouvelles classes dominantes et supérieures ont compris que la domination économique et culturelle serait d’autant plus efficace qu’elle s’exercerait au nom du bien et de l’ouverture. De Bordeaux à Paris en passant par Lyon, elle vote à gauche ou à droite pour des candidats du modèle mondialisé et vit majoritairement dans l’une des quinze premières métropoles de France. Déguisés en hipsters, les nouveaux Rougon-Macquart peuvent se livrer à la « curée » (1) en imposant à la société française un modèle économique et territorial d’une rare violence, un modèle anglo-saxon, celui de la mondialisation. Ce basculement radical s’est réalisé sans contestation sociale majeure grâce à la mise en scène d’une opposition factice entre les partisans de la « société ouverte » et ceux du « repli ». Associées au camp du repli, les classes populaires et leurs revendications deviennent inaudibles. Débarrassées de la question sociale, les nouvelles classes dominantes et supérieures imposent leur modèle au nom de la modernité, de l’ouverture, et même de l’égalité. Après plusieurs décennies de recomposition économique et sociale des territoires, la « France d’en haut » vit désormais protégée dans de nouvelles citadelles. Si les métropoles mondialisées en sont l’illustration la plus visible, les citadelles invisibles, sociales et culturelles celles-là, illustrent bien plus encore l’entre-soi et le grégarisme du « monde de l’ouverture ».
Derrière le mythe de la société ouverte et égalitaire des métropoles cosmopolites, nous assistons donc au retour des citadelles médiévales, de la ville fermée, et à la consolidation d’un modèle inégalitaire de type anglo-saxon. Cette réalité est occultée grâce à la fabrication d’un discours consensuel et positif sur les bienfaits de la métropolisation (c’est-à-dire l’organisation du territoire autour d’une quinzaine de grandes villes), la société ouverte, le réseau. Les classes dominantes n’hésitant pas, tout en installant un modèle inégalitaire, à chanter les vertus de la « mixité sociale ». Une posture qui permet opportunément de dissimuler le grégarisme social des gagnants de la mondialisation, la radicalité d’un conflit de classes qui ne dit pas son nom, les tensions culturelles inhérentes à l’émergence d’une société mondialisée et multiculturelle.
Car les territoires métropolitains ne sont pas seulement le lieu de la captation du patrimoine, des richesses et de l’emploi, ils sont aussi celui de la fabrication de la pensée unique, ce discours du système médiatique et politique qui permet aux classes dominantes de dissimuler le réel, celui d’une société inégalitaire et sous tensions, derrière la fable de la société ouverte. La société des Bisounours n’existe pas. Le bobo en trottinette n’est pas un petit soldat perdu du monde de l’enfance. Détachée de toute appartenance collective autre que celle de son milieu, la nouvelle bourgeoisie surfe sur la loi du marché pour renforcer sa position de classe, capter les bienfaits de la mondialisation et se constituer un patrimoine immobilier qui rivalisera demain avec celui de l’ancienne bourgeoisie.
Protégée dans les nouvelles citadelles médiévales, loin d’un peuple devenu invisible, la nouvelle classe dominante réussit à dominer l’ensemble du champ culturel et politique au nom du bien et de la mixité. Contrairement à la bourgeoisie traditionnelle qui n’avait pu évacuer le conflit de classes, elle est parvenue à imposer l’idée d’une société sans intérêts de classe, où le « vivre-ensemble » est la norme. Partisans du libre-échange et de la diversité culturelle, les catégories supérieures ont érigé discrètement des frontières invisibles aussi efficaces que celles de la bourgeoisie d’hier.
Le mensonge de la société ouverte
Hier, la bourgeoisie, c’était le grégarisme social, l’entre-soi, le rejet de l’Autre, le refus du progrès. C’était hier. Aujourd’hui, les classes supérieures ne s’enferment plus dans le « ghetto », elles sont « ouvertes », elles considèrent que la mixité sociale, culturelle, est une nécessité. Mieux, elles font aujourd’hui la promotion du « vivre-ensemble ». Attachées aux valeurs de la République, elles défendent le « modèle social » (les 35 heures, très favorables aux cadres, un peu moins le Code du travail) et participent aux grandes mobilisations « citoyennes ». Voilà pour la partie visible.
Dans la réalité, l’entre-soi et le réseautage n’ont jamais été aussi pratiqués. Cette aimable bourgeoisie participe ainsi directement ou indirectement au plus important processus de relégation sociale et culturelle des classes populaires, en excluant par ses choix économiques et sociaux les catégories modestes des territoires qui comptent, ceux qui créent l’emploi et les richesses. La prédation qu’elles opèrent sur l’ensemble du parc de logements privés des grandes métropoles, hier destiné aux classes populaires, n’a pas d’équivalent dans l’histoire. Mieux, il se réalise à bas bruit, sans qu’à aucun moment l’emprise de dépossession ne soit questionnée, encore moins remise en question. Il faut dire que la concentration des catégories supérieures sur les territoires qui créent l’essentiel des richesses et de l’emploi s’accompagne aussi d’une emprise de ces catégories sur le débat public et son expression.
À la ghettoïsation sociale et territoriale des catégories supérieures fait écho une ghettoïsation intellectuelle qui interdit tout débat. La concentration des gagnants de la mondialisation sur les territoires qui regroupent richesse et création d’emploi produit ainsi une pensée, un discours unique, celui de la mondialisation et de la métropolisation heureuse. Un discours relayé par des médias et une classe politique qu’elles animent majoritairement. Inutile, donc, d’attendre un référendum sur la mondialisation, l’Europe le Tafta ou la réforme territoriale.
Les classes supérieures ne jurent que par le « réseau » (virtuel ou de villes). L’idée est de justifier en douceur la relégation en laissant croire qu’habiter dans le Cantal ou à New York, c’est la même chose. Qu’à Guéret ou à Lyon, les champs du possible sont identiques, puisqu’on est également « connecté ». Les discours fumeux sur l’interconnexion, la mobilité, l’échange, la mixité sociale, l’ouverture à l’Autre ne visent qu’à dissimuler les effets d’un développement économique inégalitaire et d’une organisation territoriale excluant l’essentiel des catégories modestes. Les mythes du « réseau » et de la « mobilité » promus par les médias et une intelligentsia acquise aux bienfaits de la métropolisation agissent comme des leurres parfaits pour mieux masquer la captation des richesses. D’un côté, le réseau « virtuel » (pour les classes populaires), de l’autre le véritable réseau des classes supérieures qui repose sur l’entre-soi. En se regroupant dans les grandes métropoles européennes et régionales, les cadres et professions intellectuelles supérieures font indirectement le même choix, celui de la ghettoïsation sociale. Des stratégies qui s’appliquent aussi dans les « quartiers mixtes » des grandes villes où les pratiques d’évitement résidentiel et scolaire sont la norme. Si un vernis culturel et politique permet encore de distinguer nouvelle et ancienne bourgeoisie sur les questions sociétales, elles défendent le même modèle économique. Le modèle de la classe dominante fédère ainsi des bourgeoisies en apparence opposées, mais qui bénéficient du modèle mondialisé et de son corollaire, la métropolisation.
Abritées derrière le discours de la modernité, de l’ouverture et du vivre-ensemble, les catégories supérieures participent ainsi violemment à la relégation sociale et culturelle d’une majorité des classes populaires. Par leurs choix, économiques, résidentiels, sociétaux, elles contribuent au lent processus de désaffiliation sociale et culturelle des plus modestes. Les territoires s’organiseront donc autour de nos grandes métropoles, les richesses, le pouvoir économique, financier, culturel se concentrera toujours plus et, compte tenu du poids politique et médiatique des grandes métropoles (l’essentiel de la classe politique, médiatique et politique défend ces territoires) les tenants des territoires ruraux, des petites villes et villes moyennes, des départements, ont peu de chance de se faire entendre, et ce d’autant que les classes dominantes avancent masquées.
Elles (les catégories supérieures) prônent égalité des territoires mais promotionnent la métropolisation et la gentrification. Elles demandent plus de mixité sociale, mais pratiquent le grégarisme social et un séparatisme discret grâce à l’évitement scolaire et résidentiel.
Elles font la promotion du vivre-ensemble mais participent à l’ethnicisation des territoires et à la multiplication de collèges-ghettos en contournant la carte scolaire. Au final, elles portent haut le discours républicain et le principe d’égalité, mais favorisent en réalité un modèle inégalitaire.
L’affaire est entendue, le nouveau clivage opposerait les tenants de la société ouverte au camp du repli. Dans un camp les modernes, ceux qui ont compris le sens de l’Histoire, ceux qui respectent l’autre, le monde, et de l’autre les classes populaires, les peu qualifiés, les esprits faibles, les non-diplômés. Cette opposition culturelle tend à occulter deux choses. La première est que cette fracture idéologique est d’abord sociale : les catégories supérieures d’un côté, celles qui bénéficient à plein du nouveau modèle économique, et de l’autre des catégories populaires, grandes perdantes de la mondialisation. Mais cette opposition est plus perverse, car elle tend à déplacer la question sociale derrière une posture morale qui vise à légitimer les choix économiques et sociaux des catégories supérieures depuis plusieurs décennies. Le clivage société ouverte/société fermée place de fait les catégories supérieures dans une position de supériorité morale : toute critique du système économique et des choix sociétaux s’apparente alors à la posture négative du repli, elle-même annonciatrice du retour des années 1930. À ce petit jeu, les classes populaires sont forcément perdantes socialement, culturellement et politiquement. L’échec politique des contempteurs du modèle économique, de Chevènement à l’extrême droite en passant par l’extrême gauche, illustre l’efficacité de cette stratégie.
Le stratagème est d’autant plus pervers que cette société ouverte, mixte, égalitaire, portée dans les discours ne correspond en rien à la réalité, et encore moins à celle que revendiquent ces catégories supérieures. Dans les faits, la société mondialisée est une société fermée où le grégarisme social, le séparatisme, l’évitement et la captation des richesses et des biens n’ont jamais été si puissants. Ainsi, loin du conte pour enfants rabâché sans interruption depuis vingt ans par les médias, qui oppose les bons et les méchants, la société n’est pas divisée entre les partisans éclairés de l’ouverture contre des opposants incultes et fermés. La véritable fracture oppose ceux qui bénéficient de la mondialisation et qui ont les moyens de s’en protéger et ceux qui en sont les perdants et ne peuvent se protéger de ses effets.
Derrière le discours de l’ouverture apparaît la réalité d’une ghettoïsation des classes supérieures, la généralisation d’un système de reproduction sociale et l’avènement d’un système politique oligarchique et d’alternance unique. Les postures mondialistes et multiculturalistes des élites permettent d’accompagner en douceur l’avènement d’un système profondément inégalitaire et de mettre à bas un système de protection sociale anachronique dans la logique de mondialisation.
Les élites et les classes supérieures ont compris que la société mondialisée et multiculturelle n’est viable qu’à la condition de se protéger des tensions qu’elle génère mécaniquement. Tensions sociales liées à l’éviction des classes populaires du projet économique, tensions culturelles liées à l’apparition d’une société aux identités multiples. Cette protection ne viendra pas d’un État-providence mécaniquement désarmé par les choix économiques et sociaux, mais de discrètes stratégies individuelles qui passent notamment par un renforcement de l’entre-soi et par l’évitement résidentiel et scolaire des immigrés.
Ne pratiquant ni l’ouverture ni le « vivre-ensemble réel » (le vivre-ensemble avec celui qui gagne 1 000 euros par mois, celui qui implique la cohabitation réelle avec l’Autre dans son immeuble, au travail et la scolarisation de ses enfants dans les mêmes collèges que les enfants de l’Autre), les classes dominantes et supérieures n’ont de cesse d’accuser ceux qui n’ont pas les moyens de se protéger d’être responsables des tensions.
Le discours d’ouverture au monde et aux autres apparaît pour ce qu’il est : un écran de fumée visant à dissimuler l’émergence d’une société fermée, séparée au plus grand bénéfice des classes supérieures.
Les classes dominantes continueront à nous parler d’une société ouverte, d’une « ville en réseau », de « mobilité pour tous », d’une organisation territoriale adaptée à l’économie-monde, du vivre-ensemble, tout en bâtissant discrètement de nouvelles citadelles médiévales. Des citadelles imprenables édifiées au nom de la rationalité économique et qui captent l’essentiel des richesses et de l’emploi. Entourées de murs d’enceinte bien plus imposants et solides que ceux du Moyen Âge. Car le mur de l’argent permet de rejeter bien plus efficacement la plèbe définitivement hors les murs dans cette France périphérique. Villes fermées, les métropoles permettent aux classes dominantes et supérieures de pratiquer sans l’assumer un « séparatisme républicain » d’une rare efficacité. Ainsi, le maintien dans les quartiers de logements sociaux de ces villes de catégories populaires immigrées et précaires permet d’offrir une main-d’œuvre bon marché à l’économie métropolitaine et contribue à l’image factice de « ville ouverte ». Aujourd’hui, 60 % des immigrés vivent dans les quinze premières métropoles.
Nous y sommes donc, cette société ouverte multiculturelle et cool, celle des grandes métropoles, a gagné, elle nous a ramenés au Moyen Âge. En quelques décennies, protégée dans ses nouvelles citadelles, la nouvelle bourgeoisie s’est approprié le patrimoine, les emplois, les richesses, le pouvoir politique et culturel. Cette captation s’est réalisée en douceur grâce à la production d’un discours dominant qui vise à occulter les conséquences de cette captation. La domination de classe doit rester invisible. La France populaire et périphérique doit rester invisible, les classes supérieures doivent se confondre avec la classe moyenne. La réaction hystérique du monde médiatique et universitaire vis-à-vis de l’emploi de l’expression « bobo », qui visait à réintroduire un rapport de classes entre les arrivants (catégories supérieures et/ou intellectuelles) et les autochtones (classes populaires traditionnelles et immigrées), est très révélatrice d’une volonté de dissimuler la captation par une nouvelle bourgeoisie d’un patrimoine destiné hier aux classes populaires, mais aussi de l’essentiel des bienfaits de la mondialisation.
Note
1. La Curée est le titre d’un roman d’Émile Zola qui décrivait l’enrichissement de la bourgeoisie parisienne de la fin du xixe siècle grâce à la restructuration urbaine initiée par le baron Haussmann. Si le contexte d’aujourd’hui n’est pas celui de grands travaux, la captation discrète des terrains et immeubles hier destinés aux catégories modestes est tout aussi efficace.
L’antifascisme, une arme de classe (p. 171-179)
L’insécurité sociale et culturelle dans laquelle ont été plongées les classes populaires, leur relégation spatiale, débouchent sur une crise politique majeure. L’émergence d’une « France périphérique », la montée des radicalités politiques et sociales sont autant de signes d’une remise en cause du modèle économique et sociétal dominant. Face à ces contestations, la classe dominante n’a plus d’autre choix que de dégainer sa dernière arme, celle de l’antifascisme. Contrairement à l’antifascisme du siècle dernier, il ne s’agit pas de combattre un régime autoritaire ou un parti unique. Comme l’annonçait déjà Pier Paolo Pasolini en 1974, analysant la nouvelle stratégie d’une gauche qui abandonnait la question sociale, il s’agit de mettre en scène « un antifascisme facile qui a pour objet un fascisme archaïque qui n’existe plus et n’existera plus jamais » (1). C’est d’ailleurs en 1983, au moment où la gauche française initie son virage libéral, abandonne les classes populaires et la question sociale, qu’elle lance son grand mouvement de résistance au fascisme qui vient. Lionel Jospin reconnaîtra plus tard que cette « lutte antifasciste en France n’a été que du théâtre » et même que « le Front national n’a jamais été un parti fasciste » (2). Ce n’est pas un hasard si les instigateurs et financeurs de l’antiracisme et de l’antifascisme sont aussi des représentants du modèle mondialisé. De Bernard-Henri Lévy à Pierre Bergé, des médias (contrôlés par des multinationales), du Medef aux entreprises du CAC 40, de Hollywood à Canal Plus, l’ensemble de la classe dominante se lance dans la résistance de salon. « No pasaràn » devient le cri de ralliement des classes dominantes, économiques ou intellectuelles, de gauche comme de droite. Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de constater, comme le fait le chercheur Jacques Leclerq (3), que les groupes « antifa » (qui s’étaient notamment fait remarquer pendant les manifestations contre la loi Travail par des violences contre des policiers), recrutent essentiellement des jeunes diplômés de la bourgeoisie (4).
Véritable arme de classe, l’antifascisme présente en effet un intérêt majeur. Il confère une supériorité morale à des élites délégitimées en réduisant toute critique des effets de la mondialisation à une dérive fasciste ou raciste. Mais, pour être durable, cette stratégie nécessite la promotion de l’« ennemi fasciste » et donc la surmédiatisation du Front national… Aujourd’hui, on lutte donc contre le fascisme en faisant sa promotion. Un « combat à mort » où on ne cherche pas à détruire l’adversaire, mais à assurer sa longévité. Il est en effet très étrange que les républicains, qui sauf erreur détiennent le pouvoir, n’interdisent pas un parti identifié comme « fasciste ». À moins que ces nouveaux partisans n’aient pas véritablement en ligne de mire ce petit parti, cette « PME familiale », mais les classes populaires dans leur ensemble. Car le problème est que ce n’est pas le Front national qui influence les classes populaires, mais l’inverse. Le FN n’est qu’un symptôme d’un refus radical des classes populaires du modèle mondialisé. L’antifascisme de salon ne vise pas le FN, mais l’ensemble des classes populaires qu’il convient de fasciser afin de délégitimer leur diagnostic, un « diagnostic d’en bas » qu’on appelle « populisme ». Cette désignation laisse entendre que les plus modestes n’ont pas les capacités d’analyser les effets de la mondialisation sur le quotidien et qu’elles sont aisément manipulables.
Expert en « antifascisme », Bernard-Henri Lévy a ainsi ruiné l’argumentaire souverainiste, celui de Chevènement, en l’assimilant à une dérive nationaliste – lire : fasciste. Du refus du référendum européen à la critique des effets de la dérégulation, du dogme du libre-échange, toute critique directe ou indirecte de la mondialisation est désormais fascisée. Le souverainisme, une « saloperie », nous dit Bernard-Henri Lévy. Décrire l’insécurité sociale et culturelle en milieu populaire, c’est « faire le jeu de ». Dessiner les contours d’une France fragilisée, celle de la France périphérique, « c’est aussi faire le jeu de ».
Illustration parfaite du « fascisme de l’antifascisme (5) », l’argument selon lequel il ne faudrait pas dire certaines vérités, car cela « ferait le jeu de », est régulièrement utilisé. Il faut dire que les enjeux sont considérables. Si elle perd la guerre des représentations, la classe dominante est nue. Elle devra alors faire face à la question sociale et assumer des choix économiques et sociétaux qui ont précarisé les classes populaires. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la multiplication des procès en sorcellerie et le nouveau maccarthysme des « libéraux-godwiniens ». L’expression du philosophe Jean-Claude Michéa vise à dénoncer l’utilisation systématique par les libéraux de la théorie du juriste Mike Godwin selon laquelle « plus une discussion en ligne dure longtemps (sur Internet), plus la probabilité d’y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Hitler s’approche de 1 ».
Pour la classe dominante, la défense même de gens ordinaires devient suspecte. Pour avoir évoqué la « décence commune des gens ordinaires », leurs valeurs traditionnelles d’entraide et de solidarité, le philosophe s’est retrouvé sur la liste des dangereux « réactionnaires » (autre synonyme de fasciste), bref, de ceux qui « font le jeu de » (6). La technique est d’ailleurs utilisée pour tous les chercheurs ou intellectuels qui auraient l’audace de proposer une autre représentation du peuple et de ses aspirations. De la démographe Michèle Tribalat au philosophe Michel Onfray, la liste des « fascisés » s’allonge inexorablement au rythme de la délégitimation de la classe dominante. On pourrait multiplier les exemples, mais la méthode est toujours la même : fasciser ceux qui donnent à voir la réalité populaire.
Face à une guerre des représentations qu’elle est en train de perdre, la classe dominante en arrive même à fasciser les territoires ! La « France périphérique » est ainsi présentée comme une représentation d’une France blanche xénophobe opposée aux quartiers ethnicisés de banlieue. Peu importe que la distinction entre les territoires ruraux, les petites villes et les villes moyennes et les métropoles n’ait jamais reposé sur un clivage ethnique, peu importe que la France périphérique, qui comprend les DOM-TOM, ne soit pas homogène ethniquement et culturellement, l’objectif est avant tout d’ostraciser et de délégitimer les territoires populaires. Et, inversement, de présenter la France des métropoles comme ouverte et cosmopolite. La France du repli d’un côté, des ploucs et des ruraux, la France de l’ouverture et de la tolérance de l’autre. Mais qu’on ne s’y trompe pas, cet « antiracisme de salon » ne vise absolument pas à protéger l’« immigré », le « musulman », les « minorités » face au fascisme qui vient, il s’agit d’abord de défendre des intérêts de classe, ceux de la bourgeoisie.
Si l’arme de l’antifascisme permet à moyen terme de décrédibiliser toute proposition économique alternative et de contenir la contestation populaire, elle révèle aussi l’isolement des classes dominantes et supérieures. Cette stratégie de la peur n’a en effet plus aucune influence sur les catégories modestes, ni dans la France périphérique, ni en banlieue. C’est terminé. Les classes populaires ne parlent plus avec les « mots » de l’intelligentsia. Le « théâtre de la lutte antifasciste » (7) se joue devant des salles vides.
En ostracisant, et en falsifiant, l’idéologie antifasciste vise à isoler, atomiser les classes populaires et les opposants au modèle dominant en créant un climat de peur. Le problème est que cette stratégie de défense de classe devient inopérante et, pire, est en train de se retourner contre ses promoteurs. La volonté de polariser encore plus le débat public entre « racistes et antiracistes », entre « fascistes et antifascistes » semble aussi indiquer la fuite en avant d’une classe dominante qui n’est pas prête à remettre en question un modèle qui ne fait plus société. Réunie sous la bannière de l’antifascisme, partageant une représentation unique (de la société et des territoires), les bourgeoisies de gauche et de droite sont tentées par le parti unique. Si les « intellectuels sont portés au totalitarisme bien plus que les gens ordinaires », une tentation totalitaire semble aussi imprégner de plus en plus une classe dominante délégitimée, et ce d’autant plus qu’elle est en train de perdre la bataille des représentations.
Ainsi, quand la fascisation ne suffit plus, la classe dominante n’hésite plus à délégitimer les résultats électoraux lorsqu’ils ne lui sont pas favorables. La tentation d’exclure les catégories modestes du champ de la démocratie devient plus précisé. L’argument utilisé, un argument de classe et d’autorité, est celui du niveau d’éducation des classes populaires. Il permet de justifier une reprise en main idéologique. En juin 2016, le vote des classes populaires britanniques pour le Brexit a non seulement révélé un mépris de classe, mais aussi une volonté de restreindre la démocratie. Quand Alain Mine déclare que le Brexit, « c’est la victoire des gens peu formés sur les gens éduqués » (9) ou lorsque Bernard-Henri Lévy insiste sur la « victoire du petit sur le grand, et de la crétinerie sur l’esprit » (10), la volonté totalitaire des classes dominantes se fait jour. Les mots de l’antifascisme sont ceux de la classe dominante, les catégories modestes l’ont parfaitement compris et refusent désormais les conditions d’un débat tronqué.
Notes
1. L’Europeo, 26 décembre 1974, interview de Pasolini publiée par la suite dans le livre Écrits corsaires, Champs- Flammarion, 2009.
2. « Répliques », France Culture, 29 septembre 2007 et Lionel Jospin, Lionel raconte Jospin, Seuil, 2009.
3. Auteur de « Ultragauche, autonomes, émeutiers et insurrectionnels », AFP, 3 juin 2016.
4. Un constat qui fait écho à l’analyse de Pasolini de 1968 Dans ses Écrits corsaires, l’écrivain disait se sentir plus proche du « CRS fils d’ouvriers ou de paysans » que de « l’étudiant fils de notaire ».
5. Pasolini, Écrits corsaires, op. cit.
6. Frédéric Lordon, « Impasse Michéa », La Revue des livres, septembre 2013.
7. « Répliques », France Culture, 29 septembre 2007 et Lionel Jospin, Lionel raconte Jospin, Seuil, 2009.
8. Simon Leys, Orwell ou l’horreur de la politique, Champs/Flammarion, 1984.
9. Marianne, 29 juin 2016.
10. Le Monde, 26 juin 2016.