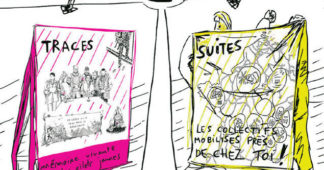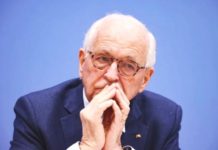Odette Auzende*
May 27, 2025
Le cinéma polonais, en particulier celui des années 1945-1989, a connu son heure de gloire dans le monde entier, ce qui mérite d’être analysé. Il faut aussi penser à la question pourquoi les films connus et diffusés en Pologne mais aussi en Occident tranchent avec beaucoup d’autres films ou séries télévisées polonaises d’avant 1989 massivement plébiscitées par le public polonais à l’époque et encore aujourd’hui, et ignorées en Occident. Cet article a l’avantage de nous montrer à la fois la richesse de ce cinéma, son côté souvent avant-gardiste et parfois absurde, mais il doit aussi nous faire réfléchir sur le fait qu’un Etat se proclamant socialiste a pu financer des oeuvres contraires aux dogmes caricaturaux répandus en Occident sur le “socialisme réel”. En posant la question de la censure et de ce qu’elle a pu interdire ou plus souvent tenter de modifier, il faut rajouter la question de ce qu’elle a laissé diffuser et pourquoi.
La Rédaction
Il est à noter qu’aucun film présenté en Occident n’est du registre de la comédie, même si la cinématographie polonaise en a produit quelques-uns. Mais l’image que donne la Pologne en Occident est celle d’un pays extrêmement grave, focalisé sur les drames qu’il a connus et les problèmes politiques et sociaux majeurs qui en ont découlé. Les pays occidentaux y ont été naturellement sensibles, ce dont témoignent les nombreuses nominations et les prix reçus. Cette approche occidentalo-centrée du cinéma polonais a permis de faire connaître mondialement des chefs-d’œuvre incontestables, financés d’ailleurs par l’État socialiste, mais elle a laissé de côté non seulement les comédies, mais aussi les séries télévisées et les films sur la vie des Polonais tels que la majorité l’a vécue sur le moment, c’est-à-dire sans remettre en cause les sentiments patriotiques héroïsant ou les principes de base mis de l’avant par le régime socialiste. Sans creuser donc sur la situation politique ou les troubles moraux qui imprégnaient les élites polonaises, traditionnelles mais aussi souvent non conformistes par rapport aux normes nouvelles de la société socialiste, mais aussi par rapport aux côtés absurdes des normes acceptées sans sourciller en Occident et qui pouvaient heurter les Polonais.
Le cinéma polonais de 1945 à 2019, vu en Occident – printemps 2025
Odette Auzende*
Le cinéma polonais a eu une très longue histoire, très riche. Nous allons nous intéresser à la période allant de 1945 à 2020, où la production de films en Pologne fut foisonnante et où on découvrit en Occident un cinéma bien spécifique. Nous préciserons les structures encadrant l’industrie cinématographique polonaise durant cette période et les films qui furent exploités dans les salles d’Europe occidentale.[1]
Note : est considéré comme « film polonais » tout film réalisé par un(e) Polonais(e) et financé, au moins en partie, par des fonds polonais[2].
La sortie de la guerre
A la sortie de la guerre, les fonds cinématographiques polonais étaient détruits. La création, la production et la distribution des films furent placées sous le contrôle de l’entreprise d’État Film Polski, devenue en 1952 l’Office Central du Cinéma, dirigé par un sous-secrétaire d’État au ministère de la Culture.
L’Institut cinématographique, fondé en 1945 à Cracovie, forma les metteurs en scène de la nouvelle génération comme Jerzy Kawalerowicz et Wojciech Has. L’institut fut remplacé en 1948 par l’École supérieure du cinéma à Łódź. L’évolution du cinéma polonais fut cependant sérieusement influencée à partir de 1949 et jusqu’en 1956 par les directives idéologiques du régime, axées sur l’esthétisme du réalisme socialiste.
De 1955 à 1962 : l’Ecole de cinéma polonaise
L’École supérieure du cinéma de Łódź devint en 1959 l’École supérieure d’art dramatique et de cinéma ; parmi ses élèves, des noms qui furent par la suite bien connus en Occident, notamment Roman Polanski, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi et Jerzy Skolimowski. Durant les années 1955-1962, les cinéastes souhaitèrent abandonner le réalisme socialiste. Dans un climat de relative liberté politique, les thèmes privilégiés furent l’histoire récente de la Pologne, en particulier la Seconde Guerre mondiale, et le rapport des héros avec l’Histoire.
Le film d’Andrzej Wajda : « Ils aimaient la vie » (1957) raconte la résistance polonaise contre les nazis, dans une vision à la fois romantique et tragique. Wajda s’intéressait aux existences en marge, aux espoirs déçus. En contestant la vision officielle héroïsante, il a fait œuvre de contre-propagande. Il ne s’agit donc pas d’un panégyrique de la résistance, mais le portrait d’une révolte écrasée. Cette vision amère et désenchantée valut à Wajda de vives critiques dans son pays, mais le film obtint à Cannes le Prix spécial du Jury :
Lors des derniers jours de l’insurrection de Varsovie, un groupe de volontaires emprunte sur ordre le canal des égouts afin de se rendre auprès d’autres combattants réunis au centre-ville. Traqués, ils se retrouvent gazés par leurs assaillants. La mort, la folie et la paranoïa font des victimes parmi eux… A l’arrivée, ils trouvent un charnier de victimes et un ennemi triomphant et se sentent trahis par le haut commandement, qui les a envoyés à une mort certaine en leur donnant ordre de rejoindre le centre-ville.
Figure emblématique de l’École de cinéma polonaise, Jerzy Kawalerowicz réalisa en 1959 « Le
Train de Nuit » qui reçut de nombreux prix, dont le prix Georges Méliès :
Deux inconnus, Jerzy et Marta, se retrouvent par hasard avec des billets pour la même chambre dans un train de nuit à destination de la côte de la mer Baltique ; ils acceptent à contrecœur de partager le compartiment à deux lits réservé aux hommes. À bord se trouve également l’amant éconduit de Marta, qui refuse d’accepter sa décision de rompre. Lorsque la police entre dans le train à la recherche d’un meurtrier en fuite, tout semble désigner l’un des personnages principaux comme le coupable.
Jerzy Kawalerowicz réalisa en 1961 « Mère Jeanne des Anges » pour lequel reçut le Prix du Jury au Festival de Cannes :
Au XVIIe siècle, à Smolensk, un prêtre, le père Józef Suryn, enquête sur un cas de possession démoniaque d’un couvent dont l’abbesse, Mère Jeanne, est la plus possédée. Les prêtres parviennent à exorciser l’abbesse. Mais peu après, la possession démoniaque s’intensifie. Le Père Suryn reçoit les démons de Mère Jeanne par amour pour elle. La nuit, persuadé que le seul moyen de sauver l’abbesse est d’obéir aux ordres de Satan, il s’empare d’une hache et tue deux personnes.
Au début des années 1960, l’École de cinéma polonaise fut supprimée, les films produits étant jugés incompatibles avec la ligne du Parti Ouvrier unifié polonais au pouvoir. La cinématographie fut placée en 1961 sous la tutelle du Ministère de la Culture et de l’Art. L’Office Central du Cinéma intervenait uniquement dans les œuvres achevées, mais le Ministre avait le pouvoir d’arrêter le tournage ou la postproduction d’un film.
La « nouvelle vague » polonaise des années 1960
De jeunes cinéastes de l’École de Łódź se tournèrent alors vers des sujets plus contemporains.
Roman Polanski, en cinq ans d’études, réalisa huit courts-métrages, dont un muet de quinze minutes aux accents surréalistes, « Deux hommes et une armoire », qui remporta la médaille de bronze à l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958 :
Deux hommes sortent de la mer en portant une armoire. Arrivés en ville, ils tentent de s’en séparer en l’offrant au premier venu, mais tous refusent, et ils ne font que des mauvaises rencontres.
Son premier long-métrage, « Le Couteau dans l’eau » (1962), un thriller fondé sur le désir, la violence et la cruauté, remporta le Prix de la critique à la Mostra de Venise. Jerzy Skolimowski, lui-même étudiant à l’École nationale de cinéma de Łódź, était l’auteur du scénario et des dialogues :
Un couple polonais possède un petit yacht sur lequel il invite un étudiant qui n’a pour bagages qu’un sac, un couteau à cran d’arrêt et deux blue-jeans. Au fur et à mesure de la croisière, les relations entre l’hôte et l’étudiant s’enveniment du fait de leur différence de culture. Un jour, une dispute éclate, l’étudiant est jeté à l’eau, l’hôte s’absente pour prévenir les secours. Mais l’étudiant revient sur le bateau et séduit la femme.
Ce film n’étant pas du goût du pouvoir, Polanski quitta la Pologne pour la France. Jerzy Skolimowski resta en Pologne, pour un temps.
`Durcissement du régime et crise de 1968
Dans les années 1963-1967, le cinéma polonais plongea dans la crise. Les changements, en particulier les départs des professeurs, affectèrent sérieusement l’école de Łódź où s’exerça désormais une censure interne, qui resta en vigueur jusqu’aux années 1980.
Jerzy Skolimowski réalisa la trilogie des aventures d’un jeune homme en colère et inadapté. Le premier film fut « Signe particulier : néant » (1964). Le film fut tourné durant les études du réalisateur à Łódź. Il devait en effet régulièrement y réaliser des courts-métrages pour passer ses examens et il décida de faire en sorte que tous ses films et essais soient liés entre eux pour qu’ils constituent, à la fin, un long métrage entier. Ainsi il n’aurait pas à travailler comme assistant réalisateur, s’étant déjà montré capable de réaliser un long métrage :
Un étudiant peu travailleur, appelé sous les drapeaux, passe une dernière journée sur les lieux de sa vie avant de monter dans le train des conscrits.
Le film ne sortit qu’après qu’il ait tourné son deuxième film, l’administration ne sachant que faire du premier, tellement elle était étonnée qu’on puisse réaliser un film ainsi.
« Walkower », son second film, fut tourné en 1965 :
Un jeune homme désœuvré se laisse convaincre par un entraîneur de participer à un combat de boxe.
Jerzy Skolimowski reçut le grand prix de Bergame pour son troisième film, « La Barrière », en 1966 :
Un jeune étudiant erre dans la grande ville, son univers mental est dominé par l’horreur de la contrainte. On suit ses déambulations agitées et ses élucubrations les plus folles.
En 1967 il réalisa « Haut les mains », interdit par la censure car considéré comme une charge anticommuniste même si elle visait le stalinisme officiellement désavoué depuis 1956, le héros ayant abandonné tous les idéaux qu’il avait lorsqu’il était étudiant :
Dix ans après la fin de leurs études de médecine, cinq jeunes gens se retrouvent à bord d’un train de marchandises. Ils évoquent leur passé commun, le temps où la Pologne était régentée par le stalinisme : ils avaient été chargés d’accoler des panneaux de papier afin d’ériger un immense portrait de Staline pour le défilé du premier mai. Or sur l’affiche, Staline avait été affublé de deux paires d’yeux.
Jerzy Skolimowski décida alors de ne plus tourner en Pologne[3]. Le film ne fut présenté (hors compétition) au Festival de Cannes qu’en 1981.
Les années 1970 : les années de « L’homme de marbre » et « L’homme de fer »
Les révoltes ouvrières de décembre 1970 ouvrirent une nouvelle ère en politique. La situation du cinéma polonais s’améliora. Krzysztof Zanussi s’interrogea sur la morale, sur la mort, sur la connaissance, sur la relation nature-culture, sur le progrès de l’intelligence, ce qu’il poursuivit ensuite tout au long de sa carrière.
À partir de 1974, Wojciech Has travailla comme professeur à l’École de cinéma de Łódź.[4] Individualiste et seul réalisateur polonais de l’époque à ne pas avoir sa carte au Parti communiste, il refusa de traiter les thèmes directement liés à l’histoire de la Pologne, ce qui entraîna que ses films ne furent, à l’époque, pas diffusés en Occident.
Krzysztof Kieślowski délaissa le documentaire et mit en scène son premier long-métrage de fiction, « Le Personnel » (1975) :
Un jeune homme honnête est engagé comme tailleur dans une compagnie de théâtre à Varsovie, et découvre les coulisses : les jalousies, la corruption, les disputes, la vindicte. A la suite d’un conflit, il doit dénoncer un collègue sur ordre de la direction.
Andrzej Wajda réalisa « L’Homme de marbre » (1976), qui attira en Occident le grand public, et pas seulement les cinéphiles. Il remporta en 1978 le Prix FIPRESCI[5] au Festival de Cannes :
En 1976, à Cracovie, pour son premier reportage à la télévision, une jeune femme entreprend une enquête sur le sort d’un ouvrier glorifié au cours des années 1950 pour son rendement au travail, dont elle a trouvé la statue de marbre abandonnée. Elle le recherche, découvre qu’il a connu des revers (représailles de ses compagnons de travail, problèmes conjugaux, procès politique), et rencontre à son tour des obstacles.
En 1978 le pape Jean-Paul II fut élu et en septembre 1980 suite à une vague de grèves Solidarność naquit. En août 1980, Les grévistes signèrent avec le pouvoir des accords à Gdansk et le cinéma polonais vécut un moment de liberté d’expression.
Le premier film d’Agnieszka Holland, « Acteurs provinciaux » (1979), remporta le Prix de la Critique internationale au Festival de Cannes en 1980 :
Un metteur en scène de Varsovie arrive dans une petite ville de province pour y monter un classique du répertoire polonais. L’acteur principal de la troupe pense qu’il détient enfin le moyen de se faire connaître et de rejoindre un théâtre plus prestigieux, mais très rapidement, ses espoirs sont déçus, le metteur en scène, arriviste et blasé, affaiblit son enthousiasme en trahissant le message idéaliste de la pièce.
Son film suivant, « Fièvre » (1981), fut présenté au 31e Festival international du film de Berlin :
Lors de la Révolution de 1905, la Pologne est partagée entre l’Autriche-Hongrie, le Reich allemand et la Russie. Inspiré de l’Histoire d’une bombe prévue pour commettre un attentat de l’écrivain socialiste Andrzej Strug, le film retrace la vie d’une bombe et des différentes personnes qui la détiennent.
Wajda réalisa « L’Homme de fer » en 1981, suite de « L’homme de marbre ». Le film obtint la Palme d’or au Festival de Cannes et une nomination à l’Oscar du meilleur film étranger lors de la 54e cérémonie des Oscars :
Pendant les grèves des chantiers navals de Gdańsk au début des années 80, un ouvrier marqué par la mort de son père milite en faveur des droits sociaux. Le gouvernement communiste charge alors un employé de la télévision d’État d’infiltrer le mouvement et d’enquêter sur l’ouvrier afin de le discréditer aux yeux de l’opinion publique. Au cours de son investigation, l’enquêteur réalise qu’il est victime d’une manipulation et finit par se joindre aux grévistes.
1981-1989 – La loi martiale
Le 13 décembre 1981, le général Jaruzelski imposa la loi martiale. Les films subirent une censure renforcée et certains films tournés pendant les années 1980-1981 furent interdits de diffusion (ce furent les « films sur étagères »).
« Les Frissons » (1981) de Wojciech Marczewski, montre comment on fabriquait des petits socialistes dans les camps de vacances pour enfants des années 1950. Il fut retiré des écrans à la suite de la proclamation de la loi martiale par le général Jaruzelski. Toutefois, le film remporta le Grand prix du jury et le prix FIPRESCI à la Berlinale 1982 :
Dans les années cinquante, dans la banlieue d’une grande ville, grandit Tomasz, treize ans. À l’école, on remplace un vieux professeur de polonais par un jeune militant de l’Union de la Jeunesse Polonaise (ZMP). Tomasz, dont le père a été arrêté par la sécurité d’Etat, se trouve confronté au discours de propagande. Puis l’école organise un camp d’été et Tomasz est choisi pour participer à cette activité de boy-scouts « rouges » destinée à former les futurs activistes de la ZMP et du Parti. Octobre 1956 voit les premières révoltes de masse contre le stalinisme, et le retour de Gomulka au pouvoir malgré I’opposition des Soviétiques.
« Le Hasard » (1981) de Krzysztof Kieślowski fut interdit pendant six ans par le régime communiste et finalement présenté au public en 1987 :
Un jeune homme cherche sa voie, imposée en partie par le poids des traditions familiales et la volonté de son père. Il abandonne des études pour connaître le hasard d’une autre vie. A la gare, son destin dépend du train après lequel il court : trois possibilités sont présentées successivement, conduisant à des avenirs différents.
L’association des cinéastes polonais (SFP) fut suspendue. Le « studio X » de Wajda dut se dissoudre. La crise économique plongea la Pologne des années 1980 dans l’incertitude et le doute. Des cinéastes se turent, d’autres réalisèrent leurs films à l’étranger.
L’abolition de l’état de guerre le 22 juillet 1983 donna un nouvel espoir à certains cinéastes polonais. Andrzej Wajda tourna « Chronique des événements amoureux » (1985) :
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, deux adolescents polonais de conditions sociales éloignées s’éprennent l’un de l’autre.
En juillet 1987, le Parlement abolit le monopole d’État dans la production cinématographique. Les films “mis sur l’étagère” depuis 1981 furent autorisés de distribution.
Agnieszka Holland tourna « Complot » en 1988, inspiré par l’enlèvement et l’assassinat du père Popiełuszko, figure emblématique du mouvement Solidarność :
Un officier de la police secrète, fanatique et déséquilibré, décide de tuer un jeune prêtre populaire, le père Alec, afin de briser le mouvement Solidarność qui menace le régime communiste.
Krzysztof Kieślowski réalisa la suite de dix films « Le Décalogue » (1988) qu’il tourna pour la télévision publique TVP, qui donnait leur chance aux cinéastes débutants. Les dix films « Le Décalogue » reçurent le prix FIPRESCI à la Mostra de Venise et figurent, pour leur valeur morale, sur la liste vaticane de films importants :
Un seul Dieu tu adoreras. Tu ne commettras point de parjure. Tu respecteras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne seras pas luxurieux. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne convoiteras pas la femme d’autrui. Tu ne convoiteras pas les biens d’autrui.
1990-2005 – La douloureuse transition
Le cinéma polonais refléta l’économie polonaise lors du passage à l’économie de marché. Ce furent des productions hollywoodiennes qui assurèrent 85 % des recettes du marché polonais, ce qui contribua à affaiblir le film polonais jusque-là financé par l’Etat. Après cinquante ans d’absence, des producteurs de cinéma privés réapparurent. En 1989, il y en avait 10, en 2001, ils étaient déjà plus de 400. C’est le développement du marché de la télévision qui permit aux sociétés de production privées d’émerger. Cependant, en difficulté face à une rude concurrence des chaînes commerciales, la chaîne TVP se retira peu à peu du financement du cinéma.
Le Fonds Eurimages, créé par le Conseil de l’Europe le 26 octobre 1988, vint en soutien aux coproductions (les équipes de tournage de deux pays différents ou plus doivent être associées, chacune devant financer au minimum 10 % du budget total) et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles. La Pologne reçut trois types d’aides : à la coproduction, puisque plusieurs films ont été réalisés grâce à ce fonds[6] ; à la distribution où des subventions furent accordées à certains distributeurs ; aux salles de cinéma : en furent bénéficiaires les exploitants de certaines salles.
En 1990, Agnieszka Holland tourna « Europa Europa », film franco-polono-allemand inspiré de l’autobiographie de Salomon Perel, qui lui valut un Golden Globe et la nomination pour l’Oscar du meilleur scénario adapté :
En novembre 1938, la famille de Salomon Perel fuit l’Allemagne et s’établit à Łódź. Lorsque la Pologne est envahie par les armées d’Hitler, ses parents l’envoient vers l’est. Il se retrouve dans un orphelinat à Grodno, apprend le russe, se plie à la propagande soviétique et devient jeune Komsomol. Quand l’orphelinat est bombardé, il est capturé, mais parvient à se faire passer pour un Volksdeutsche, prisonnier des communistes. Devenu interprète dans l’unité de la Wehrmacht, sous uniforme allemand, il tente de passer chez les Soviétiques, mais ce sont les soldats soviétiques qui capitulent et il devient un héros de guerre allemand. Il entre à l’Institut des jeunesses hitlériennes, dissimulant à chaque instant sa judéïté. Tourmenté par le sort de ses parents, il décide de retourner à Łódź mais le ghetto étant interdit aux non-juifs, il ne peut qu’entrevoir l’état du ghetto sans parvenir à établir le moindre contact. En avril 45, il se rend aux troupes soviétiques mais manque se faire exécuter comme traître. La présence de son frère Isaac, rescapé des camps et de la liquidation du ghetto de Łódź le sauve in extremis de l’exécution sommaire. Les deux frères partent finalement pour la Palestine.
Le premier film d’Andrzej Wajda après la fin du socialisme fut le film germano-britannico-polonais « Korczak » (1990). Ce médecin et pédagogue refusa d’abandonner les deux cents enfants dont il avait la charge dans le ghetto de Varsovie. Le film se concentre sur la période des trois dernières années de la vie du célèbre docteur, scientifique réputé dont les émissions radiophoniques, les conférences en Europe et les livres de fiction avaient fait connaître les méthodes :
Inspiré du journal qu’il a tenu jusqu’au dernier jour, l’essentiel du film se passe dans le ghetto de Varsovie, où Korczak est enfermé avec les enfants de l’orphelinat juif qu’il a fondé et s’efforce par tous les moyens de subvenir à leurs besoins ; il choisit d’être déporté puis gazé avec eux à Treblinka.
En 1990, un Comité du cinéma fut créé pour financer des projets de films sur le budget du Ministère de la Culture.
Jerzy Skolimowski revint en Pologne : ce fut son premier tournage depuis vingt ans dans son pays natal. Il tourna « Ferdydurke », en 1991. Le titre original, « 30 Door Key » est une quasi-homophonie du titre du roman de Witold Gombrowicz. Skolimowski resta fidèle au texte, transposant l’enchaînement des scènes décrites dans le livre, mais déplaçant l’action en 1939 peu de temps avant l’invasion de la Pologne. Le film fut globalement mal accueilli par la critique et fut un échec public.
Dans cette histoire pleine d’humour noir, un homme de trente ans se transforme en un adolescent. Enferré dans sa vie adolescente où se succèdent les rixes entre bandes adverses, les combats de grimaces parodiant les gestes de la messe, la vie de pensionnaire et les vacances à la campagne chez sa vieille tante, le narrateur est condamné à errer dans un univers qui n’est plus le sien.
Mais nombre de réalisateurs partirent à la recherche de nouvelles opportunités à l’étranger : Agnieszka Holland partit en France d’abord, puis à Hollywood. Krzysztof Kieślowski partit en France où il réalisa « La Double Vie de Véronique » (1991) :
Deux petites filles, nées en Pologne et en France, sont identiques, avec une voix magnifique et une même malformation cardiaque. La Polonaise meurt en chantant dans un récital. La Française, qui profite sans le savoir des expériences et de la sagesse de son double, a la sensation qu’elle n’est pas seule au monde et que quelqu’un guide sa vie, la contraignant à arrêter de chanter et à éviter la même mort. La vie quitte ainsi la Polonaise pour se perpétuer dans le corps et l’âme de la Française.
Krzysztof Kieślowski tourna ensuite la trilogie « Trois couleurs : Bleu, Blanc, Rouge » (1992-1994), financée par le Fonds Eurimages, sur la devise de la France « Liberté, Égalité, Fraternité ». Il remporta le Lion d’or à Venise pour « Bleu » en 1992, l’Ours d’argent à Berlin pour « Blanc » en 1994.
Bleu (liberté) : Après la mort dans un accident de voiture de son mari, un grand compositeur, et de leur fille Anna, Julie doit commencer une nouvelle vie. L’assistant de son mari la sort de son isolement en terminant le Concerto pour l’Europe, œuvre laissée inachevée par le compositeur.
Blanc (égalité) : Karol, coiffeur polonais, a tout perdu après son divorce avec Dominique, sa femme française. Après avoir enfin réussi à retourner dans son pays, il se lance dans diverses entreprises et se fait passer pour mort dans l’espoir de la revoir. Dans un étrange retour de flammes, Dominique revient en Pologne et y finit en prison.
Rouge (fraternité) : Valentine ramène chez son propriétaire une chienne qu’elle vient de blesser avec sa voiture. Son maître vit seul. Après plusieurs visites, ce juge d’instruction à la retraite lui fait part de ses écoutes téléphoniques illégales des conversations de ses voisins. Ils finissent par se lier d’amitié, permettant l’échange de confidences.
Andrzej Żuławski avait toujours vécu entre Paris et Varsovie ; il avait tourné « L’important c’est d’aimer », « Possession », « La Femme publique », « L’Amour braque » et « La Note bleue », films qui ne sont pas considérés comme polonais, la Pologne n’intervenant pas dans la coproduction. Ce n’est qu’en 1996 qu’il tourna « Chamanka », film franco-helvético-polonais :
À Varsovie, une étudiante, surnommée « l’Italienne » rencontre le professeur d’anthropologie Michał. Lors de fouilles avec ses étudiants, ils découvrent le corps bien conservé d’un chaman, vieux de plus de deux mille ans, mort lorsque l’arrière de son crâne a été écrasé. Les chercheurs consomment les champignons trouvés sur le chaman et, dans un délire, tentent de le ramener à la vie. Dans un moment d’illumination, Michał parle à l’esprit du chaman qui lui révèle qu’il a été tué par une femme qui voulait s’emparer de son pouvoir magique. Michał rompt alors avec l’Italienne. Elle lui écrase l’arrière du crâne, comme celui du chaman, et mange son cerveau.
En 2000, « La Vie comme maladie mortelle sexuellement transmissible » de Krzysztof Zanussi remporta le Grand Prix au Festival international du film de Moscou.
Tomasz apprend qu’il a une maladie mortelle. Il demande son ex-femme de financer son opération à Paris. Mais il est déjà trop tard pour guérir. Il n’est lui reste qu’attendre la mort et à trouver quelqu’un qui l’aiderait à comprendre et à accepter l’évanescence.
Le Comité du cinéma, qui avait été créé en 1990, fut démantelé le 1er avril 2002. Il incarnait le soutien de l’Etat et ne fut pas remplacé. L’Etat se retira de la production de films en général, et sa contribution au financement de ceux qu’il accepta de soutenir fut de plus en plus faible.
En 2002, « Le Pianiste », que Roman Polanski réalisa avec le soutien de Canal+ Polska, obtint la Palme d’or du Festival de Cannes. Tiré de l’histoire réelle de Władysław Szpilman, il raconte comment le musicien survécut dans le ghetto de Varsovie jusqu’à l’arrivée de l’armée soviétique :
Władysław Szpilman est le pianiste officiel de la Radio polonaise. Tandis que sa famille est déportée, il est caché par des résistants polonais. Il trouve ensuite quelque temps refuge dans un hôpital déserté, puis dans une maison en ruine, peu avant l’arrivée de l’Armée rouge. Il se cache des Allemands, mais finit par être découvert par un officier allemand mélomane qui lui procure chaque jour, secrètement, la nourriture nécessaire à sa survie. À la fin des combats, il manque de peu d’être abattu par les insurgés polonais, parce qu’il porte le manteau d’officier allemand que lui a laissé son protecteur. Après la guerre, W. Szpilman reprend le cours normal de sa vie et son métier de pianiste.
La création cinématographique polonaise depuis 2005
En 2005, l’État polonais mena une réforme globale du secteur cinématographique et créa l’Institut polonais du film. Des cinémas, distributeurs, diffuseurs de programmes, y compris la télévision publique, opérateurs de plates-formes numériques et câblo-opérateurs, furent tenus de fournir 1,5% de leur chiffre d’affaires annuel à l’Institut, ces contributions devenant une composante majeure du financement de la production cinématographique. En 2012 fut créée la Commission polonaise du film (FCP), ayant pour mission le développement du secteur audiovisuel en Pologne.
De nombreux cinéastes de générations différentes revinrent sur le passé. Andrzej Wajda revint dans « Katyń » (2007) sur le grand tabou de l’ère socialiste : les massacres des officiers polonais commis selon la version la plus crédible par les Soviétiques à la suite de son invasion de la Pologne en 1939 :
Le film présente le massacre de Katyń du point de vue des femmes, épouses et mères, qui ont voulu savoir ce qu’étaient devenus les officiers polonais arrêtés par l’armée soviétique en 1939. Il montre leurs tentatives pour établir la vérité.
Andrzej Jakimowski tourna « Un conte d’été polonais » (2007) primé à la Mostra de Venise ainsi qu’au Festival du film de Gdynia :
Dans la petite gare d’un village polonais, un jeune garçon ne perd pas espoir que son père revienne, persuadé qu’il peut jouer avec le destin. Il sème des pièces de monnaie sur les rails et joue avec ses soldats de plomb « porte bonheur » pour que le destin fasse revenir son père.
Partiellement autobiographique, le film de Jacek Borcuch « Tout ce que j’aime » (2011) raconte les manifestations ouvrières à Gdansk et la loi martiale de Jaruzelski, vus par un adolescent chantant dans un groupe de punk rock :
Au printemps 1981, quatre amis créent un groupe de punk rock. Dans les rues, le syndicat Solidarité déclenche des grèves massives. Le punk rock n’est pas très bien vu des autorités. Le héros découvre que toute action peut être considérée comme politique, lorsque l’époque est à la répression et à la censure.
Le sort de Juifs polonais continua également à préoccuper les réalisateurs. En témoigne « Sous la ville » (2011) d’Agnieszka Holland :
Lwow, Pologne 1944 : les nazis ordonnent l’épuration du ghetto. Des habitants creusent un tunnel sous leur maison pour rejoindre les égouts de la ville. Un employé municipal accepte de cacher onze de ces fugitifs contre paiement. Mais petit à petit, il va mettre sa vie et celle des siens en danger, afin de protéger “ses Juifs”, même quand l’argent vient à manquer.
« Ida » (2013) de Paweł Pawlikowski, coproduction polono-danoise, remporta l’Oscar du meilleur film en langue étrangère lors de la 87e cérémonie des Oscars :
En 1962, une jeune fille, qui croit se prénommer Anna, a été élevée dans un couvent, où elle est novice. La Mère supérieure lui annonce qu’elle a une tante, sa seule parente en vie, et l’envoie à Varsovie pour qu’elle la connaisse. Sa tante, Wanda, lui dévoile qu’elle s’appelle Ida Lebenstein, qu’elles sont Juives et que les parents d’Ida sont morts pendant la guerre. Wanda relate que dans les années 1951-1952 elle était procureure. Elle a fait condamner à mort des gens considérés comme des ennemis du régime socialiste. Wanda essaye de convaincre Ida d’éprouver la vie ordinaire avant de décider de son avenir. Elles trouvent l’assassin des parents d’Ida, qui avait eu au final peur de cacher des Juifs et enterrent leurs restes dans un cimetière juif. Ida retourne au couvent, mais, hésitante, ne prononce pas ses vœux. Quand Wanda se suicide, Ida va à l’enterrement puis passe la nuit avec un homme. Mais au matin, Ida met ses habits du couvent et s’en va. Elle a choisi son destin.
Maciej Pieprzyca fut primé à l’international en 2013 (Grand Prix des Amériques, Prix du Public, Prix du Jury œcuménique au Festival des films du monde de Montréal) pour « La vie est belle », inspiré d’une histoire vraie :
Mateusz atteint de l’infirmité motrice cérébrale a des grandes difficultés à communiquer avec son entourage. Mais malgré son handicap, il fait face à la réalité avec patience et courage.
L’année 2015 vit la consécration du nouveau cinéma polonais : Małgorzata Szumowska reçut l’Ours d’argent au 65e Festival international du film de Berlin pour « Body » (2015). Située dans la Pologne d’aujourd’hui, cette histoire réunit un procureur, sa fille anorexique et un thérapeute qui communique avec les morts, explorant trois points de vue opposés sur le corps et l’âme :
Olga, une jeune femme souffrant de troubles alimentaires et d’un deuil non résolu, vit avec son père, qui soupçonne leur appartement d’être hanté. Anna, la thérapeute d’Olga et médium, intervient.
Bien qu’en marge de la production polonaise, parce que réalisé par une cinéaste non polonaise, « Les innocentes », en 2016, est un film dramatique franco-polonais coproduit, coécrit et réalisé par Anne Fontaine, réalisatrice franco-luxembourgeoise, à partir du récit authentique de Madeleine Pauliac, résistante et médecin-chef à l’Hôpital français de Varsovie. Le film fut nommé quatre fois pour les César 2017 :
En Pologne, en 1945, Mathilde, jeune médecin de la Croix-Rouge française, est appelée dans un couvent de bénédictines, où l’une des religieuses va accoucher. Neuf mois auparavant, des soldats soviétiques ont violé les religieuses, et sept sont enceintes. La jeune femme revient plusieurs fois pour aider ces jeunes femmes, dans le déni, dans le rejet, ou découvrant la maternité. Elle se lie avec les religieuses, dont Maria, pour qui « la foi, c’est vingt-quatre heures de doutes et une minute d’espérance ». Maria découvre que la Mère supérieure a abandonné deux nouveau-nés à « la Providence », et cherche comment sauver les autres. Mathilde se lie avec le jeune médecin juif qu’elle doit mettre dans le secret, ne pouvant faire face seule aux accouchements. Un peu de joie et d’espoir finit par sortir de cette situation, le couvent étant transformé en orphelinat.
En 2018, « Cold War » de Pawlikowski remporta le prix de la mise en scène à Cannes :
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté, qui veut vivre à l’ouest, et une jeune chanteuse vivent un amour difficile. Malheureuse à l’ouest, elle retourne en Pologne. Lui y rentre illégalement, est arrêté et condamné à 15 ans de détention. Quand il est libéré, c’est un homme fini. Elle lui demande de la délivrer d’une existence qu’elle ne peut plus supporter. Dans une église en ruine isolée, ils s’agenouillent et se disent les formules habituelles à la cérémonie de mariage, puis ils se suicident.
« Twarz » (« La face ») de Małgorzata Szumowska reçut en 2018 l’Ours d’argent au 68e Festival international du film de Berlin :
Un homme subit un accident qui le défigure et subit en urgence une des premières greffes du visage en Pologne. Il doit se réapproprier ce nouveau visage, et apprendre à supporter les réactions de ses proches et de tous ceux qu’il côtoie. Fan de hard-rock, le héros reste toujours positif et enthousiaste, au contraire de ceux qui l’entourent.
En 2019, ce fut la tragi-comédie « La Communion » de Jan Komasa, dans lequel un jeune délinquant se fait passer pour un prêtre, qui représenta la Pologne aux Oscars. Tiré de faits réels, le film dépeint une société contemporaine qui instrumentalise le bien et le mal :
Daniel, un jeune de 20 ans, vit dans un centre éducatif surveillé en semi-liberté qui accueille des délinquants souvent violents. Il se retrouve empêtré dans un mensonge non-prémédité en prétendant être prêtre. Un curé lui confie son intérim sans en informer l’évêché. Daniel assure alors les responsabilités du prêtre. Il plaît à la majorité des paroissiens, mais le maire est plus sévère à son égard. Il est finalement dénoncé et le véritable père vient le déloger, sans pour autant révéler l’usurpation aux villageois. Daniel est alors renvoyé dans le centre.
Conclusion
Les films polonais vus en Europe occidentale sont bien moins nombreux que ceux tournés par des réalisateurs polonais et distribués uniquement en Pologne ou dans les pays de l’est. Mais beaucoup de ces films projetés en Occident illustrent les problèmes politiques et sociaux rencontrés dans le pays et, à ce titre, ont particulièrement intéressé le public occidental.
41 films sont cités ici. Ils couvrent la majeure partie des films polonais sortis en Europe occidentale durant la période considérée. Leur production fut parfois difficile : problèmes de financement, problèmes de censure politique ou religieuse… qui pouvaient entraver le tournage ou refuser la distribution d’un film, exil de réalisateurs… Le recours à la coproduction avec des pays occidentaux fut souvent nécessaire, et est indiqué lorsque c’est le cas.
La moitié de ces films abordent des sujets au cœur des préoccupations nationales, politiques et religieuses polonaises : les guerres (5), le ghetto de Varsovie et son insurrection (3), le socialisme et la période stalinienne (3), la guerre froide (3), Solidarnosc et les manifestations associées (3), la religion et l’acceptation de la destinée humaine (6).
L’ésotérisme, l’étrange et le rêve ont aussi leur place (4), notamment avec Polanski qui, après son départ de Pologne, continua sur cette voie. Les autres films abordent des thèmes plus universalistes, traitant des relations humaines, de psychologie, de l’attitude face au handicap et à la mort (11) et du rôle du hasard dans la vie (3).
*Slavisante et professeur émérite d’informatique.
Notes :
[1] Les sources proviennent essentiellement des sites https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_polonais (« Cinéma polonais »), https://shs.cairn.info/revue-le-courrier-des-pays-de-l-est-2003-10-page-65?lang=fr (« Le cinéma polonais 1989-2002 – Crise conjoncturelle ou structurelle ? ») et des divers sites décrivant les films.
[2] Nous verrons qu’il y a une exception, un film réalisé par une Occidentale, mais financé en partie par la Pologne et traitant d’un sujet polonais.
[3] Il revint en 1991.
[4] Il tourna notamment le « Manuscrit trouvé à Saragosse » en 1965, « La Poupée » en 1968, « La Clepsydre » en 1973.
[5] Prix de la critique internationale remis depuis 1946 lors du Festival de Cannes par un jury constitué de critiques de cinéma internationaux.
[6] Comme « Trois couleurs. Rouge. Blanc. Bleu » de Krzysztof Kieslowski (voir page suivante)
Nous rappelons à nos lecteurs que la publication d’articles sur notre site ne signifie pas que nous adhérons à ce qui y est écrit. Notre politique est de publier tout ce que nous considérons comme intéressant, afin d’aider nos lecteurs à se forger leur propre opinion. Parfois aussi, nous publions des articles avec lesquels nous sommes en total désaccord, car nous croyons qu’il est important que nos lecteurs soient informés d’un éventail d’opinions aussi large que possible.